Trump voit-il l’Iran à travers une optique perturbée – qu’en détruisant l’Iran, il apporte la paix par la force ?
L’appel téléphonique du 18 mars entre les présidents Trump et Poutine a eu lieu. Cela a été un succès, dans la mesure où il a permis aux deux parties de qualifier le résultat de «positif». Et cela n’a pas conduit à une rupture (en raison de la moindre des concessions de Poutine – une trêve sur les infrastructures énergétiques) – ce qui aurait facilement pu se produire (c’est-à-dire aboutir à une impasse – avec Trump fustigeant Poutine, comme il l’a fait avec Zelensky), étant donné les attentes fantaisistes et irréalistes tissées en Occident selon lesquelles ce serait la «réunion décisive» pour une division finale de l’Ukraine.
Cela a peut-être aussi été un succès, dans la mesure où cela a jeté les bases des devoirs non faits, qui doivent maintenant être traités par deux équipes d’experts sur les mécanismes détaillés du cessez-le-feu. On s’est toujours demandé pourquoi cela n’avait pas été abordé plus tôt par l’équipe américaine à Riyad (manque d’expérience ?). Après tout, c’est parce que le cessez-le-feu a été traité comme une entité auto-créée, en vertu d’une signature américaine, que les attentes occidentales se sont envolées dans la conviction que les détails n’avaient pas d’importance ; Tout ce qui restait à faire – dans cette estimation (erronée) – était de «partager le gâteau».
Jusqu’à ce que les mécanismes d’un cessez-le-feu – qui doivent être complets puisque les cessez-le-feu échouent presque toujours – soient mis en place, il y avait peu à discuter sur ce sujet mardi. Comme on pouvait s’y attendre, la discussion a donc (apparemment) semblé se tourner vers d’autres questions, principalement économiques, et vers l’Iran, soulignant une fois de plus que le processus de négociation entre les États-Unis et la Russie ne se résume pas à l’Ukraine.
Alors, comment passer à la mise en œuvre du cessez-le-feu ? C’est simple. Il faut commencer par démêler l’écheveau des obstacles qui bloquent la normalisation des relations. Poutine, en ne s’intéressant qu’à un seul aspect du problème, a fait remarquer que :
«Les sanctions [seules] ne sont ni temporaires ni ciblées. Elles constituent [plutôt] un mécanisme de pression systémique et stratégique contre notre pays. Nos concurrents cherchent perpétuellement à contraindre la Russie et à diminuer ses capacités économiques et technologiques… ils élaborent ces paquets sans relâche».
Il y a donc beaucoup de débris géostratégiques accumulés à traiter et à corriger, qui remontent à de nombreuses années, avant qu’une normalisation globale puisse commencer sérieusement.
Ce qui est évident, c’est que si Trump semble être pressé, Poutine, en revanche, ne l’est pas. Et il ne se laissera pas bousculer. Sa propre circonscription ne tolérera pas un accord bâclé à la hâte avec les États-Unis qui imploserait plus tard au milieu de récriminations de tromperie – et de Moscou ayant de nouveau été dupé par l’Occident. Le sang russe est investi dans ce processus de normalisation stratégique. Il doit fonctionner.
Qu’y a-t-il derrière l’évidente hâte de Trump ? Est-ce le besoin d’une vitesse vertigineuse sur le front intérieur pour aller de l’avant, avant que les forces cumulées de l’opposition aux États-Unis (et de leurs frères en Europe) aient le temps de se regrouper et de torpiller la normalisation avec la Russie ?
Ou bien Trump craint-il qu’un long intervalle avant la mise en œuvre du cessez-le-feu ne permette aux forces d’opposition de faire pression pour la reprise des livraisons d’armes et du partage de renseignements, alors que le rouleau compresseur militaire russe poursuit son avancée ? Craint-il, comme l’a averti Steve Bannon, qu’en réarmant l’Ukraine, Trump ne «s’approprie» effectivement la guerre et n’assume la responsabilité d’une défaite massive de l’Occident et de l’OTAN ?
Ou peut-être Trump anticipe-t-il que Kiev pourrait s’effondrer de manière inattendue (comme cela s’est produit pour le gouvernement Karzaï en Afghanistan). Trump est parfaitement conscient du désastre politique qui s’est abattu sur Biden à la vue des images d’Afghans s’accrochant aux pneus des avions de transport américains au moment de leur départ (à la manière du Vietnam), alors que les États-Unis évacuaient le pays.
Une fois de plus, il pourrait s’agir de quelque chose de différent. J’ai appris de mon expérience dans la facilitation des cessez-le-feu en Palestine/Israël qu’il n’est pas possible de faire un cessez-le-feu à un endroit (disons Bethléem), alors que les forces israéliennes incendiaient simultanément Naplouse ou Jénine. La contagion émotionnelle et la colère d’un conflit ne peuvent être contenues dans une seule localité ; elles déborderaient sur l’autre. On a essayé. L’un a contaminé les intentions sincères implicites de l’autre.
La raison de la hâte de Trump est-elle principalement qu’il soupçonne que son soutien sans réserve à Israël le conduira finalement à embrasser une guerre majeure au Moyen-Orient ? Le monde d’aujourd’hui (grâce à Internet) est beaucoup plus petit qu’avant : est-il possible d’être à la fois un «artisan de la paix» et un «artisan de la guerre» – et que le premier soit pris au sérieux ?
Trump et les politiciens américains «à la solde» du lobby pro-israélien savent que Netanyahou et ses acolytes veulent que les États-Unis contribuent à éliminer le rival régional d’Israël, l’Iran. Trump ne peut pas à la fois réduire le rôle des États-Unis en tant que «sphère d’influence» de l’hémisphère occidental, tout en continuant à faire peser le poids des États-Unis en tant qu’Hégémon mondial, ce qui entraînerait la faillite du gouvernement américain. Trump parviendra-t-il à réduire les États-Unis à une forteresse, ou les enchevêtrements étrangers – par exemple un Israël instable – conduiront-ils à la guerre et feront-ils dérailler l’administration Trump, car tout est lié ?
Quelle est la vision de Trump pour le Moyen-Orient ? Il en a certainement une, qui est enracinée dans son allégeance sans faille à l’intérêt israélien. Le plan consiste soit à détruire financièrement l’Iran, soit à le décapiter et à renforcer un Grand Israël. La lettre adressée par Trump au guide suprême iranien Ali Khamenei fixait notamment un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord sur le nucléaire.
Un jour après sa missive, Trump a déclaré que les États-Unis en étaient «aux derniers moments» avec l’Iran :
«Nous ne pouvons pas les laisser posséder une arme nucléaire. Quelque chose va se produire très bientôt. Je préférerais un accord de paix à l’autre option, mais l’autre option résoudra le problème».
Le journaliste américain Ken Klippenstein a fait remarquer que le 28 février, deux bombardiers B-52 en provenance du Qatar ont largué des bombes sur un «lieu tenu secret» – l’Irak. Ces bombardiers à capacité nucléaire transportaient un message dont le destinataire «était clair comme de l’eau de roche : la République islamique d’Iran». Pourquoi des B-52 et pas des F-35 qui peuvent également transporter des bombes ? (Parce que les bombes «bunker-buster» sont trop lourdes pour les F-35 ? Israël possède des F-35, mais pas de bombardiers lourds B-52).
Puis, le 9 mars, écrit Klippenstein, une deuxième démonstration a été faite : un B-52 a volé aux côtés de chasseurs israéliens lors de missions à longue portée, s’entraînant aux opérations de ravitaillement en vol. La presse israélienne a correctement rendu compte du véritable objectif de l’opération : «préparer l’armée israélienne à une éventuelle frappe conjointe avec les États-Unis contre l’Iran».
Puis, dimanche dernier, le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz s’est vanté que de multiples frappes aériennes anglo-américaines «ont éliminé» de hauts responsables houthis, indiquant très clairement que tout cela concernait l’Iran :
«Il s’agissait d’une réponse écrasante qui visait en fait plusieurs dirigeants houthis et les a éliminés. Et la différence ici est, d’une part, de s’en prendre aux dirigeants houthis, et d’autre part, de tenir l’Iran pour responsable».
Marco Rubio a développé sur CBS : «Nous rendons service au monde entier en nous débarrassant de ces types».
Trump a ensuite repris le même thème :
«Chaque coup de feu tiré par les Houthis sera considéré, à partir de maintenant, comme un coup de feu tiré par les armes et le leadership de l’IRAN, et l’IRAN sera tenu pour responsable, et en subira les conséquences, et ces conséquences seront désastreuses !»
Dans un autre article, Klippenstein écrit :
«Le menu des options de Trump pour traiter avec Téhéran comprend désormais une option qu’il n’avait pas lors de son premier mandat : la guerre totale – avec «des armes nucléaires sur la table» (l’option Trident II à faible rendement) Les documents contractuels du Pentagone et de la société que j’ai obtenus décrivent «un effort de planification interarmées unique» en cours à Washington et au Moyen-Orient pour affiner la prochaine génération d’«un conflit régional majeur» avec l’Iran. Les plans sont le résultat d’une réévaluation des capacités militaires de l’Iran, ainsi que d’un changement fondamental dans la façon dont les États-Unis mènent la guerre».
Ce qui est nouveau, c’est que la composante «multilatérale» inclut pour la première fois Israël travaillant à l’unisson avec les partenaires arabes du Golfe, que ce soit indirectement ou directement. Le plan prévoit également de nombreux scénarios et niveaux de guerre, selon les documents cités par Klippenstein, allant de l’«action de crise» (c’est-à-dire la réponse aux événements et aux attaques) à la planification «délibérée» (qui fait référence à des scénarios définis découlant de crises qui dégénèrent). Un document met en garde contre la «possibilité distincte» que la guerre «dégénère en dehors de l’intention du gouvernement des États-Unis» et ait un impact sur le reste de la région, exigeant une approche multidimensionnelle.
Les préparatifs de guerre pour l’Iran sont si étroitement limités que même les entreprises sous contrat impliquées dans la planification de la guerre n’ont pas le droit de mentionner les parties non classifiées, note Klippenstein :
«Alors que le Pentagone tente souvent de proposer aux présidents une série d’options militaires pour les orienter vers celle qu’il privilégie, Trump a déjà montré sa propension à choisir l’option la plus provocante».
«De même, le feu vert donné par Trump aux frappes aériennes israéliennes sur Gaza, qui ont fait des centaines de morts lundi dernier, mais qui visaient ostensiblement les dirigeants du Hamas, peut être considéré comme conforme à la tendance à choisir l’option belligérante».
Après avoir réussi à assassiner le général iranien Qassem Soleimani en 2020, Trump semble avoir compris que l’action agressive est relativement peu coûteuse, note Klippenstein.
Comme Waltz l’a fait remarquer dans son interview à la presse :
«La différence, c’est que ces attaques [au Yémen] n’étaient pas des piqûres d’épingle, des va-et-vient, qui se sont finalement révélées être des attaques inefficaces. Il s’agissait d’une réponse écrasante qui visait en fait plusieurs dirigeants houthis et les a éliminés».
Klippenstein met en garde : «2024 est peut-être derrière nous, mais ses leçons ne le sont pas. L’assassinat par Israël de hauts responsables du Hezbollah au Liban a été largement perçu par Washington comme un succès retentissant avec peu d’inconvénients. Trump a probablement repris le même message, ce qui a conduit à son attaque contre les dirigeants houthis cette semaine».
Si les observateurs occidentaux considèrent que tout ce qui se passe est une répétition des représailles de Biden ou des attaques limitées d’Israël contre les systèmes d’alerte précoce et de défense aérienne de l’Iran, ils peuvent mal comprendre ce qui se passe en coulisses. Ce que Trump pourrait maintenant faire, ce qui sort tout droit du manuel israélien, serait d’attaquer le commandement et le contrôle de l’Iran, notamment ses dirigeants.
Cela aurait très certainement un effet profond sur les relations de Trump avec la Russie et la Chine. Cela ébranlerait tout sentiment de Moscou et de Pékin selon lequel Trump est capable de conclure des accords. Quel prix aurait alors sa réinitialisation de la «vision d’ensemble» de «pacificateur» s’il, à la suite des guerres au Liban, en Syrie et au Yémen, commençait une guerre contre l’Iran ? Trump voit-il l’Iran à travers une optique perturbée – qu’en détruisant l’Iran, il apporte la paix par la force ?
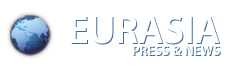 Eurasia Press & News
Eurasia Press & News




