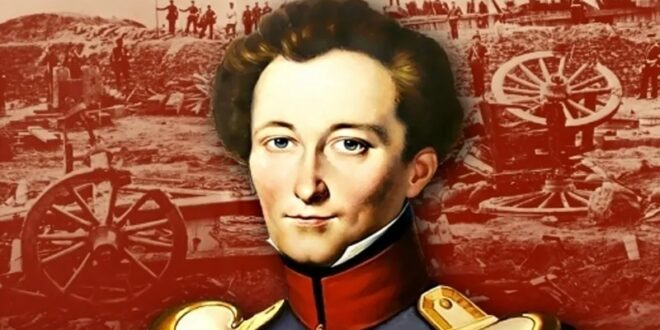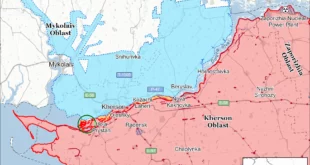Paix dictée ou paix négociée en Ukraine ?
Le 28 avril dernier Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN en visite à Kiev, a rassuré formellement Volodymyr Zelensky que la guerre contre la Russie pouvait être encore gagnée par l’Ukraine et il a réaffirmé : «La Russie doit bien le comprendre. Elle ne pourra pas gagner. Elle ne pourra pas nous avoir à l’usure !»
Or à quel type de guerre appartient-elle, cette «Opération Militaire Spéciale», déclenchée par Moscou contre Kiev le 24 février 2022 ?
Clausewitz et le but de guerre
Suivant les questionnements de Clausewitz sur le but ultime de la guerre (Zweck), qui se confond toujours avec une certaine paix, la modalité du retour à la paix devient le critère de la distinction entre deux espèces de guerre. Paix imposée ou dictée d’une part, paix négociée de l’autre. Celle où la finalité est d’abattre l’ennemi et que l’on veuille l’anéantir politiquement ou que l’on veuille le désarmer, et celle où l’on veut seulement faire quelques conquêtes aux frontières de son empire. La paix devient le critère de l’alternative. Dans le premier cas, le vainqueur impose à l’ennemi mis à terre n’importe quelles conditions, y compris éventuellement la disparition de l’État, voire l’élimination physique de la population (R. Aron, «Clausewitz. Penser la guerre» – Age européen p.102 103). Dans la pire des hypothèses pour Kiev, la fin politique de la guerre, considérée dans sa totalité (neutralisation), influe sur les objectifs militaires dans la guerre (Ziel) et concerne tout aussi bien la stratégie, ou l’emploi des combats, que la modalité du retour à la paix au moment où s’arrêtent les hostilités (dépeçage de l’Ukraine ?). Cependant «la politique (internationale) ne détermine adéquatement la fin (Zweck) qu’à la condition d’apprécier exactement la nature de la guerre, en fonction des circonstances (régionales, indirectes et systémiques), qui la conditionnent» (p.107). La distinction établie par Clausewitz dans le cadre du «système européen», peut-elle rester la même dans le «système planétaire», où changent la multiplicité des acteurs, la configuration des forces et des volontés, les caractéristiques des enjeux, la diffusion des foyers de conflits, les types de sécurité et, globalement l’homogénéité et l’hétérogénéité du système (européen et mondial) ?
Pourra-t-on geler par une paix négociée ou dictée des intérêts distincts et irréductibles, où les erreurs d’évaluations ont été multiples ?
En effet, la fin opératoire des hostilités, comme nous le rappelle Clausewitz, et l’objectif immanent à la guerre elle-même en tant qu’acte de violence, c’est de désarmer l’ennemi et désarmer l’ennemi équivaut, dans la lutte entre États, à les jeter à terre comme des lutteurs, car «tomber» constitue l’objectif propre de la lutte en tant que preuve de force, dont le but est le renversement politique de l’adversaire (en termes actuel le «regime change»). Cependant dans le conflit ukrainien «le tiers non engagé» (les États-Unis et l’OTAN, bref l’Occident collectif), resté jusqu’ici en dehors du duel formel des forces et des volontés aux prises, manifeste son influence dans l’action réciproque de l’offensive et de la défensive et, sous différentes manières, évite «d’introduire dans la philosophie (et dans la pratique) de la guerre un principe de modération, sans commettre une absurdité» (p.110).
«Pugna cessat, Bellum manet !»
Puisque la résistance à l’envahisseur dépend de la grandeur de ses moyens et de sa volonté, la force morale des Ukrainiens, qui échappe à tout calcul, serait laissée à son seul sentiment d’hostilité, vis-à-vis des Russes, en cas de paix négociée, selon le principe du «Pugna cessat, bellum manet» (la bataille cesse, mais la guerre perdure !). En définitive, la stratégie d’hostilité à la Russie, adoptée sous l’unipolarisme américain successif à l’effondrement de l’Union soviétique (1989) demeure encore déterminante aujourd’hui, perdurera avec toute probabilité au-delà d’une éventuelle paix négociée, servant d’aliment à la peur et, peut-être à tout esprit de revanche future et reste conditionnée par trois facteurs majeurs :
• L’évolution des combats sur le terrain ;
• l’unité et la fermeté de la fragile coalition occidentale ;
• l’incertitude sur le leadership européen et sur le rôle de l’Amérique après les élections présidentielles de novembre prochain.
Une paix négociée (comme masque d’une paix de capitulation) comporterait pour Moscou une victoire diplomatique face aux BRICS, à l’OCS et à l’AUKUS et un critère de mesure du succès du partenariat Russie-Chine, comportant une baisse des tensions dans le cadre du système international. Pour mieux préciser, la modalité du retour à la paix est définie par R. Aron comme le point de rencontre entre l’objectif militaire et de la fin politique (du conflit).
Pourparlers de paix de mars – avril 2022
Les révélations récentes de la revue Foreign Affairs sur l’occultation par la presse occidentale des pourparlers de paix entre Zelensky et Poutine, de mars-avril 2022 pouvant conduire à un arrêt des hostilités rappellent que Kiev et Moscou étaient prêtes à envisager des compromis extraordinaires pour mettre fin à la guerre. Si Kiev et Moscou reviennent à la table des négociations cela revient à dire que le but de la guerre n’est pas la victoire militaire, ce en quoi a échoué à Zelensky, lors de la contre-offensive des mois de juin-septembre 2023, mais le but de guerre, la neutralisation de l’Ukraine, qui n’intéressait pas les Occidentaux (Johnson-Blinken), autrement dit la sécurité de la Russie, ou encore, l’application des Accords de Minsk 1 & 2. Il reste qu’en réalité le seul point que les Russes considéraient comme non négociable était la neutralité de l’Ukraine, assortie de certaines garanties, jugées nécessaires par Kiev, à savoir que certaines puissances mondiales, dont les États-Unis, s’engagent à la défendre en cas d’attaque russe.
En revenant à la doctrine et, encore davantage à la réalité historique, la victoire militaire appartient au vocabulaire de la tactique et correspond aussi à la recommandation de J. F. C. Fuller de «penser la guerre non en elle-même, mais par rapport à la paix !», autrement dit à des rapports politiques et à des conditions de stabilité viables.
Or l’opposition de Kiev à l’objectif politique initial qui fut à l’origine du choc des forces et des volontés russes et ukrainiennes et à l’opération militaire spéciale qui en découla, comportèrent une sous-estimation de l’importance ultérieure de l’engagement. Borné à une perspective purement régionale et à une conception antagoniste des équilibres de sécurité russo-américains, Zelensky fit appel indéfiniment au soutien en ressources des Occidentaux, en jouant au chantage des uns contre les autres et à l’épouvantail d’une hypothétique invasion de l’Ukraine, de la Pologne, des Pays Baltes, et de la Moldavie de la part de Poutine.
Des négociations impossibles ?
Il rejeta à plusieurs reprises toute discussion avec Moscou signant notamment un décret, en 2022 qui déclarait officiellement toute négociation «impossible».
Le général Vadym Skibitsky (photo), numéro deux du directoire du renseignement militaire ukrainien (HUR), a avoué récemment à la revue The Economist que des discussions seront nécessaires à un moment donné, comme c’est le cas dans toute guerre. «Le général Skibitsky dit qu’il ne voit pas comment l’Ukraine pourrait remporter la guerre sur le seul champ de bataille. Même si elle était capable de repousser les forces russes à ses frontières – une perspective de plus en plus lointaine-, cela ne mettrait pas fin à la guerre», écrit la revue.
Entre temps ont changé radicalement les trois notions qui président à l’affrontement armé, celle d’ennemi, de stabilité et de système et s’est radicalisée outre mesure celle d’hostilité civilisationnelle.
En ce sens les liens entre politique et guerre nous conduisent à rendre explicite l’idée que dans les philosophies de l’action, commandées par la dualité des moyens et des valeurs morales, d’une part, et par le but politique, d’autre part, l’emploi des moyens se transforme, dès lors que le but de guerre change et que, dans le cas de l’Ukraine, on est passé d’une stratégie régionale à une stratégie globale et systémique. Ainsi ce conflit figurera comme un combat partiel de la stratégie mondiale dans laquelle il est impliqué, en vue d’une alternative hégémonique. En outre ce conflit définit la mesure des forces à mobiliser pour une grande preuve historique. Il en découle que l’entreprise hégémonique ne déterminera le conflit européen qu’à la condition d’apprécier exactement l’ampleur et la complexité de la guerre générale et globale. Dans cette perspective le conflit d’Ukraine figurera comme l’activateur indirect et le moment tactique d’une stratégie globale d’alternative systémique, celle du duel du siècle entre les États-Unis et la Chine.
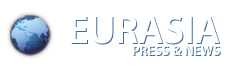 Eurasia Press & News
Eurasia Press & News