Derrière l’imposition par Trump de tarifs douaniers drastiques à la Chine, il y aurait une peur sous-jacente chez l’actuel hégémon économique d’être dépassé par le géant chinois au cours de la prochaine décennie, ce que l’on appelle le «piège de Thucydide».
La lutte entre l’hégémon et la puissance émergente
L’expression «piège de Thucydide» a été inventée par le politologue américain Graham T. Allison dans un article intitulé «Vers la guerre : l’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide ?», publié dans le magazine The Atlantic et inclus plus tard dans son livre «Destinées à la guerre : l’Amérique et la Chine peuvent-elles échapper au piège de Thucydide ?»
Avec ce terme, Allison tente d’expliquer «la tension générée par la montée d’une nouvelle puissance et la résistance de la puissance dominante ou hégémonique». Cette confrontation entre l’hégémon et la puissance montante pourrait éviter la guerre en mettant en œuvre d’énormes et douloureux ajustements dans les attitudes et les actions des deux parties ou dégénérer progressivement vers un conflit militaire ouvert, une hypothèse qui a été remplie dans 12 des 16 cas cités par Allison et qui ont été résolus «en renforçant la grande puissance ou en cédant à l’hégémonie de la puissance montante».
Ce terme pourrait être extrapolé aujourd’hui à la lutte économique et géopolitique entre les États-Unis et la Chine puisque selon les projections, entre 2030 et 2035 la Chine serait déjà l’hégémonie économique, c’est pourquoi, selon Allison, «la Chine et les États-Unis sont sur une trajectoire de collision pour entrer en guerre».
Le piège de Thucydide susmentionné génère ce qu’Allison appelle un «phénomène miroir», c’est-à-dire «un syndrome de la puissance dominante contre un syndrome de la puissance ascendante qui exacerbe les ambitions d’hégémonie de la puissance ascendante et l’insécurité et la vulnérabilité de la puissance dominante, et peut même conduire à des réactions irrationnelles, basées sur des événements apparemment sans conséquence pour une confrontation mondiale».
Guerre commerciale et technologique
Les États-Unis et la Chine estiment tous deux que la guerre s’est déplacée vers les sphères économique, financière et technologique.
Dans le secteur des télécommunications, avec le déploiement des réseaux 5G mené par des entreprises comme Huawei, la Chine a dépassé les États-Unis en termes d’infrastructures et d’adoption de masse. De même, dans le secteur des véhicules électriques, des entreprises comme BYD ont positionné la Chine comme leader de la production et des ventes soutenues par d’importants investissements publics et par l’accès à des minéraux essentiels comme le lithium.
En matière d’intelligence artificielle (IA), la Chine a également gagné du terrain, avec des modèles comme DeepSeek qui concurrencent les développements occidentaux comme ChatGPT, souvent à moindre coût et avec une plus grande efficacité sur des ressources limitées. Cela renforce son leadership en matière de publications scientifiques sur l’IA, surpassant les États-Unis en quantité.
D’autre part, les États-Unis conservent des avantages dans des domaines stratégiques tels que l’informatique quantique, où des entreprises comme IBM et Google mènent le développement, et dans les semi-conducteurs avancés, avec des entreprises comme Intel, AMD et NVIDIA dominant la conception des puces de nouvelle génération.
Bien que la Chine ait fait des progrès avec des entreprises comme SMIC (Société internationale de fabrication de semi-conducteurs), elle dépend toujours de la technologie étrangère pour fabriquer des puces de pointe en raison des restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis et leurs alliés. En outre, les États-Unis excellent dans l’innovation à fort impact, avec les brevets les plus cités au monde et une forte présence dans la recherche spatiale, illustrée par les programmes SpaceX et de la NASA tels qu’Artemis.
Technologie et armes
Les États-Unis disposent du plus gros budget militaire au monde, estimé à environ 877 milliards de dollars en 2023, selon les données du ministère de la Défense. En comparaison, le budget officiel de la Chine est d’environ 230 milliards de dollars (selon l’Institut international d’études stratégiques (IISS), bien que certains analystes suggèrent que le chiffre réel pourrait être plus élevé).
Les États-Unis disposent également d’un arsenal nucléaire plus vaste et plus diversifié (environ 3700 ogives contre 600 pour la Chine, selon la Fédération des scientifiques américains), avec des systèmes de lancement plus avancés.
Cependant, la Chine comble rapidement son retard, notamment en matière de missiles hypersoniques (comme le DF-17) et de sa flotte navale, qui dépasse déjà celle des États-Unis en nombre de navires (mais pas en tonnage ou en capacité).
En conclusion, l’intensification possible des tensions irait au-delà des personnalités de Trump et de Xi Jinping, reproduisant la thèse d’Allison selon laquelle «elle obéit aux syndromes profonds de domination et d’ascendance décrits ci-dessus, qui ont émergé de leurs dirigeants mais se projettent progressivement dans des secteurs importants de leurs populations respectives».
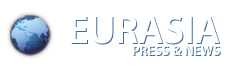 Eurasia Press & News
Eurasia Press & News




