Le Sud global est le lieu où histoire et héritage culturel sont préservés et l’«ordre international fondé sur des règles» rejeté. Quiconque nie l’histoire disparaîtra, tel un spectre rayé de la mémoire.
Lorsque Christophe Colomb posa le pied pour la première fois sur le sol américain, en 1492, il n’était pas le premier Européen à fouler ce continent. En 983, l’explorateur viking Éric le Rouge aborda le Groenland, où il fonda des colonies. Un peu plus tard, un groupe de Vikings débarqua à Terre-Neuve et y fonda une colonie. Selon certaines rumeurs, vers 1170, un marin gallois du nom de Madoc aurait également navigué jusqu’aux côtes de l’Alabama. Il existe même des rapports vagues et non confirmés selon lesquels des groupes de Phéniciens, réfugiés de Carthage après sa destruction par les Romains, auraient atteint l’Amérique du Sud. Vers 1450 au moins, il est probable que des pêcheurs portugais et bretons aient trouvé le chemin des riches zones de pêche au large des côtes de la Nouvelle-Écosse.
Par conséquent, Christophe Colomb n’est au mieux que le découvreur emblématique du Nouveau Monde, la nouvelle Atlantide. Compte tenu des doutes justifiés quant à l’exactitude de la chronologie admise, on peut toutefois s’interroger sur l’époque à laquelle les prédécesseurs de Christophe Colomb ont réellement atteint le Nouveau Monde. Il se pourrait que la plupart de ces événements se soient produits durant une période assez limitée.
Quoi qu’il en soit, il est indéniable que cette connexion entre l’Ancien et le Nouveau Monde est l’un des événements les plus importants de l’histoire mondiale entre la masse continentale eurasienne-africaine (qui représente 80% de la superficie terrestre mondiale) et les 20% restants, situés pour la plupart dans les Amériques.
Outre les perspectives qu’elle offrait en matière de commerce, d’agriculture, d’élevage et de presque toutes les autres activités, la découverte du Nouveau Monde a sans aucun doute incité les Européens à repenser leur rôle dans les dynamiques spatio-temporelles.
Il va sans dire que pour de nombreux Européens, l’annonce de la découverte du Nouveau Monde, qui s’est rapidement avérée être un continent, a été à la fois une surprise et un choc. En quelques décennies, les contours du nouveau continent ont été cartographiés et, en quelques décennies supplémentaires, une grande partie de celui-ci a été conquise par les Espagnols et les Portugais, puis transformée en colonies. Les deux principaux empires indigènes, les Aztèques et les Incas, sont alors devenus centraux dans le nouveau royaume colonial espagnol en Amérique.
En 1552, le moine dominicain espagnol Bartolomé de Las Casas fait paraître un réquisitoire cinglant contre le traitement réservé aux habitants indigènes des Caraïbes par les Espagnols : «Breve relato de la destrucción de las Indias» [Bref récit de la destruction des Indes]. L’essayiste français Michel de Montaigne a conclu que, sous bien des aspects, les Amérindiens étaient comme des enfants, tant par leur apparence que par leur développement intellectuel. Ils avaient la peau douce, peu de pilosité faciale, et leurs réflexions, ingénues et naïves, s’apparentaient à celles qu’on prête aux enfants.
«C’était un monde innocent, affirmait-il, et je crains que nous n’ayons précipité sa ruine en le contaminant, en imposant nos opinions et nos technologies à un prix trop élevé», ~ Montaigne, Essais, Paris : Gallimard, 1950, III : 6, p. 1018.
Selon lui, les Européens, considérés comme supérieurs, avaient le devoir moral de bien traiter les Indiens et de les aider à se développer et à prospérer. On peut voir dans cette attitude un précurseur de la conviction paternaliste selon laquelle il est nécessaire d’apporter une «aide au développement», une idée chère aux «progressistes» que nous sommes.
Il n’y avait qu’un pas du monde humain au monde animal. C’est précisément la démarche adoptée par le naturaliste français Georges Buffon (1707-1788), qui a établi que les mammifères d’Amérique n’atteignaient jamais la taille, le poids et le volume de leurs homologues d’Europe et d’Asie, le plus grand représentant de chaque espèce du Nouveau Monde étant toujours plus petit que celui de l’Ancien Monde. Par exemple, le puma, le plus grand prédateur américain, est bien plus petit que le tigre, le plus grand prédateur eurasien, et que le lion, son plus grand homologue africain. De même, l’éléphant, le plus grand herbivore de l’Ancien Monde, dépasse de loin le tapir américain, le plus grand herbivore indigène d’Amérique.
En revanche, parmi les espèces considérées comme inférieures dans la hiérarchie, les animaux américains étaient systématiquement plus grands que leurs homologues de l’Ancien Monde. Chez les reptiles, par exemple, le boa constrictor américain est plus grand que tous les serpents de la même catégorie de l’Ancien Monde. Il en va de même pour les insectes et les araignées, tous ceux vivant aux Amériques dépassant leurs cousins de l’Ancien Monde.
Buffon en a conclu que l’Amérique constituait un meilleur habitat pour les insectes et les reptiles, en raison de son climat plus humide, et donc de sa jeunesse géologique, deux facteurs qui la rendaient intrinsèquement malsaine pour les Européens. Selon lui, l’Amérique était plus jeune, car les eaux du grand déluge qui auraient autrefois recouvert la terre se seraient retirées plus tardivement du Nouveau Monde que de l’Ancien.
Fort de ces conclusions, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un Européen ne fasse des déclarations radicales sur les implications de l’environnement américain pour la vie humaine. Cornelius de Pauw (1739-1799), ecclésiastique et érudit allemand d’origine néerlandaise au service de la cour de Prusse, n’hésita pas à s’exprimer sans détour sur le sujet, bien qu’il n’ait jamais visité le Nouveau Monde. Dans ses «Recherches philosophiques sur les Américains» (1768-1770), il affirmait que les Amérindiens étaient inférieurs aux Européens sur tous les plans. Cette opinion concordait avec les observations de Jorge Juan et Antonio de Ulloa, deux officiers de marine et scientifiques espagnols dont les voyages en Amérique du Sud dans les années 1730 et 1740 ont donné lieu à l’ouvrage «Noticias Secretas de América, sobre el estado naval, militar y político del Perú y provincia de Quito» (1748). Ils affirmaient en outre que tous les Américains, y compris ceux nés en Amérique de parents européens, étaient inférieurs aux Européens. Ils étaient, selon eux, plus paresseux et peu enclins à la délation.
La Révolution américaine, la proclamation de l’indépendance de Saint-Domingue (Haïti) et des colonies espagnoles et portugaises (entre 1810 et 1824) ont incité le philosophe allemand Hegel à nuancer ses jugements précédents sur le Nouveau Monde. Selon lui, l’Ancien Monde, en particulier l’Europe, possédait une histoire, tandis que les Amériques se réduisaient à une simple géographie. Selon lui, l’unique partie du Nouveau Monde susceptible de prendre de l’importance et de s’affranchir de la géographie était le nord, car il avait été colonisé par des Européens du nord. L’Amérique du Nord avait donc un avenir et finirait par entrer dans l’histoire. Hegel estimait que dans les régions hispanophones et lusophones des Amériques, l’emprise de l’Église catholique romaine, si oppressante, et le caractère arriéré de l’Espagne et du Portugal, rendaient toute perspective d’avenir impossible.
Ses observations se sont avérées très pertinentes : la plupart des Européens sont encore incapables de percevoir le continent américain hors du prisme dépeint par Hegel. Ils admirent généralement le Nord (les États-Unis) au détriment du Sud (l’Amérique latine), qu’ils ont tendance à dénigrer. Sans s’en rendre compte, la plupart des spécialistes universitaires européens qui étudient l’Amérique latine suivent les préceptes de Hegel et sont traditionnellement sociologues, économistes, anthropologues, politologues, etc. Pour eux, l’Amérique latine ne semble pas vraiment avoir d’histoire.
Les États-Unis sont souvent perçus comme se situant en dehors de l’histoire, comme un phare illuminant le monde. Tocqueville a également noté que de nombreux Américains rejettent le concept même d’histoire. Plus récemment, Jean-Philippe Immarigeon a remarquablement démontré que ce rejet de l’histoire est profondément ancré dans la psyché américaine («American Parano», 2006, et «L’imposture américaine», 2009). Ainsi, en 2009, le président Obama a affirmé sans sourciller que l’automobile est une «invention américaine».
L’adoption par les États-Unis de l’évangile néolibéral comme nouvelle religion d’État, après la chute du mur de Berlin, témoigne également d’un rejet fondamental de l’histoire et de la tradition. Un phénomène qui n’a fait que creuser le fossé entre les États-Unis et le reste du monde.
Ces disparités s’étaient déjà imposées à certains Latino-Américains à la fin du XIXe siècle. Au cours des XIXe et XXe siècles, la justesse des observations de Hegel à cet égard est devenue de plus en plus manifeste. Mais il a fallu l’œil avisé de l’écrivain et philosophe uruguayen José Enrique Rodó (1871-1917) pour le souligner. Comme beaucoup de ses contemporains, il doutait de la validité de la tendance généralisée en Amérique latine à rechercher la prospérité par la rationalisation et le développement industriel. Rodó était convaincu du brillant avenir de l’Amérique latine, mais estimait que son essor ne saurait passer par les principes utilitaristes prônés par les États-Unis et appliqués à l’époque par un petit groupe de technocrates zélés au Brésil et au Mexique. Dans son essai «Ariel» (1900), il affirmait que l’engouement pour l’utilitarisme, fondé sur la science et la démocratie, ne mènerait qu’à un appauvrissement intellectuel et culturel. Selon lui, la démocratie entraverait tout développement esthétique, raffinement et noblesse, et anéantirait l’intérêt pour la culture. Il soulignait que les États-Unis étaient l’incarnation même de l’utilitarisme et affirmait la nécessité pour les Latino-Américains de cesser d’admirer un tel modèle. S’inspirant de la pièce de Shakespeare «La Tempête», Rodó a comparé les États-Unis à la créature Caliban. Selon lui, la soif de richesse et de pouvoir des États-Unis dévastait la beauté et la noblesse de l’humanité. Selon lui, l’Amérique latine pourrait échapper à la puissance et à l’influence croissantes des États-Unis en se recentrant sur le spirituel, la beauté, l’éthique et les entités immatérielles. L’Amérique latine devait incarner Ariel, la synthèse de la bonté, l’intégrité et des valeurs durables.
Le débat séculaire, notamment en Europe, sur la place du Nouveau Monde dans le temps et l’espace, brillamment analysé par Antonello Gerbi dans «La Disputa del Nuovo Mondo» (1955, traduction anglaise publiée en 1962), n’a jamais été aussi central.
Maintenant que l’empire américain semble entrer dans ce qui pourrait être à son crépuscule, l’ancienne dichotomie entre le nord et le sud du Nouveau Monde est de nouveau d’actualité. Elle n’a pas disparu, mais les frontières ont été redessinées. L’empire américain s’étend désormais à l’ensemble de l’anglosphère, à l’UE, à l’OTAN, au Japon et à la Corée du Sud. C’est là que l’argent est tout-puissant et que même l’amour et l’amitié ont un prix et peuvent être exprimés en valeur monétaire. Ses prétendues valeurs, telles que le «wokisme» et les «espaces sécurisés», sont, quand elles ne sont pas intrinsèquement offensantes et dégradantes, complètement dépourvues de sens dans un monde ancré dans des traditions séculaires, des vérités incontestables et des valeurs inaltérables.
Ce monde réel est parfois appelé le «Sud global» et correspond en quelque sorte aux pays des BRICS. Il comprend l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Asie, ainsi que certains autres pays. On pourrait définir le Sud global comme des régions où l’histoire et l’héritage culturel sont toujours préservés, et où l’«ordre international fondé sur des règles» et ses «valeurs», sont systématiquement rejetés.
Quiconque nie l’histoire est destiné à disparaître sans laisser de traces, tel un fantôme qui s’évapore dans le néant.
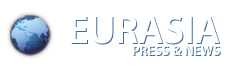 Eurasia Press & News
Eurasia Press & News




