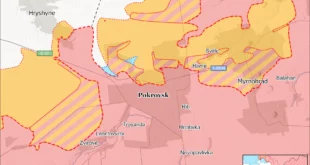Malgré leur réputation de maîtres de la communication et de l’influence mondiale, les États-Unis n’ont pas inventé la guerre de l’information. Pendant la première moitié du XXe siècle, ils se sont retrouvés à devoir rattraper les techniques déjà développées par les puissances européennes. Ce fut un parcours marqué par des tentatives, des échecs et, finalement, des succès, qui ont permis aux États-Unis de devenir une puissance hégémonique également sur le terrain de l’information.
La Première Guerre mondiale : Les débuts dans la guerre de l’information
Pendant la Première Guerre mondiale, les États-Unis n’étaient pas encore une superpuissance mondiale. Leur entrée dans le conflit, tardive, eut lieu en 1917, après l’interception du télégramme Zimmermann, révélant un plan allemand visant à s’allier avec le Mexique contre les États-Unis. Cet épisode, exploité habilement par le président Woodrow Wilson pour justifier l’entrée en guerre, montra le potentiel de la guerre de l’information pour influencer l’opinion publique.
Pour renforcer le soutien intérieur, Wilson créa le Committee on Public Information (CPI), dirigé par le journaliste progressiste George Creel. Le CPI adopta une approche moderne, utilisant la presse, la radio, le cinéma et les affiches pour mobiliser la population. La propagande reposait sur un mélange de patriotisme et de censure, mettant l’accent sur la construction d’un ennemi commun : l’Allemagne.
Cependant, après la guerre, les États-Unis démantelèrent la plupart des infrastructures liées à la guerre de l’information. Cette perte de compétences et de mémoire opérationnelle eut des conséquences significatives deux décennies plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale.
La Seconde Guerre mondiale : De la désorganisation à la réorganisation
Au début de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient à nouveau mal préparés, tant sur le plan militaire que psychologique. Le traumatisme de la Grande Dépression et l’isolationnisme ambiant rendaient difficile la mobilisation pour un nouveau conflit. Ce n’est qu’après l’attaque de Pearl Harbor, en décembre 1941, que le président Franklin Delano Roosevelt réorganisa systématiquement la stratégie de communication du pays.
Roosevelt créa l’Office of War Information (OWI), dirigé par Elmer Davis, pour gérer la propagande interne et externe. L’OWI se concentra sur deux principaux fronts : mobiliser l’opinion publique américaine et maintenir le moral des Alliés. En parallèle, il fonda l’Office of Strategic Services (OSS), dirigé par William Donovan, qui se consacra aux opérations secrètes, à la désinformation et à la manipulation psychologique.
Collaboration avec le Royaume-Uni et apprentissage accéléré
Pour combler leur retard par rapport aux puissances européennes, les États-Unis s’inspirèrent des techniques britanniques. Le Royaume-Uni, avec une longue tradition de propagande et de désinformation, représentait un modèle à suivre. L’OSS collabora étroitement avec le MI6 britannique, participant à des opérations de diversion comme celles qui aboutirent au succès du débarquement en Normandie en 1944.
Un exemple emblématique fut l’opération de désinformation qui persuada les Allemands que l’invasion alliée aurait lieu à Calais, plutôt qu’en Normandie. Ces opérations démontrèrent comment la guerre de l’information pouvait être utilisée non seulement pour influencer l’opinion publique, mais aussi pour manipuler les décisions stratégiques de l’ennemi.
Obstacles internes : Divisions et isolationnisme
Malgré leurs progrès, les États-Unis furent confrontés à des obstacles significatifs. Des divisions internes existaient entre les agences responsables de la communication ouverte, comme l’OWI, et celles impliquées dans des opérations secrètes, comme l’OSS. Cette fragmentation rendait difficile la coordination des activités liées à la guerre de l’information.
De plus, des tensions sociales internes compliquèrent la situation. Les communautés d’origine japonaise et allemande furent soumises à des contrôles stricts, avec des mesures drastiques comme l’internement des citoyens d’origine japonaise sur la côte ouest des États-Unis.
L’héritage de la guerre de l’information
La Seconde Guerre mondiale marqua un tournant dans la guerre de l’information américaine. Les États-Unis comprirent l’importance de structures permanentes pour gérer la propagande et la désinformation. Cette leçon fut cruciale pendant la Guerre froide, lorsque les États-Unis utilisèrent des techniques de guerre psychologique pour contrer l’influence soviétique.
Aujourd’hui, l’histoire de la guerre de l’information américaine offre des enseignements importants. La capacité d’influencer l’opinion publique, de manipuler les perceptions de l’ennemi et de coordonner des stratégies de communication ne repose pas seulement sur la technologie ou les ressources, mais sur une vision stratégique et une mémoire opérationnelle solides.
Au XXe siècle, les États-Unis n’ont pas inventé la guerre de l’information, mais ils ont rapidement appris à l’utiliser comme un outil de pouvoir global. Ce parcours, malgré des débuts difficiles, les a conduits à devenir l’une des puissances les plus influentes également sur le plan psychologique et communicationnel.
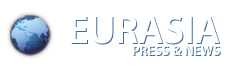 Eurasia Press & News
Eurasia Press & News