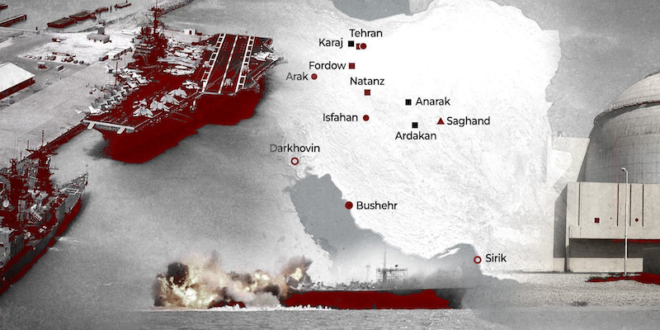Alors que Trump menace l’Iran, Washington militarise Diego Garcia, île des Chagos dans l’océan Indien érigée sur le nettoyage ethnique, le colonialisme britannique et l’aventurisme militaire.
La récente menace du président américain Donald Trump de frapper l’Iran s’il ne met pas fin à son programme nucléaire a ravivé l’intérêt pour un atout américain de longue date : Diego Garcia. Des bombardiers furtifs B-2 ont été déployés sur l’île, en théorie un territoire britannique mais en pratique une garnison américaine, suggérant que Washington se prépare à la guerre, ou qu’il fait monter les enchères via un bluff agressif.
Située au cœur de l’océan Indien, l’île de Diego Garcia offre aux États-Unis une portée inégalée sur l’Asie occidentale, l’Afrique orientale et l’Asie du Sud. Elle a servi de base de lancement pour toutes les grandes guerres menées par les États-Unis dans la région, de l’Irak à l’Afghanistan. Aujourd’hui, elle pourrait jouer un rôle clé dans une éventuelle attaque contre la République islamique d’Iran.
Mais cette île, isolée et apparemment sans controverse, est imprégnée d’injustice coloniale. Ses habitants d’origine, les Chagossiens, ont été expulsés de force pour faire place à la base. Sous la pression de Washington, le Royaume-Uni a scindé l’archipel de l’île Maurice, et l’a soumis à un nettoyage ethnique.
En 2024, la Grande-Bretagne a finalement accepté de restituer les îles à Maurice, mais le bail américain reste en vigueur. Pour l’instant, Diego Garcia est entre les mains des Américains et s’apprête une fois de plus à servir de rampe de lancement pour une guerre impérialiste.
Du paradis au génocide
Autrefois colonisées par la France puis par la Grande-Bretagne, les îles Chagos abritaient une population créole unique, descendante d’esclaves africains et de travailleurs indiens. Pendant des générations, les Chagossiens ont vécu en paix sur ces îles, se forgeant une identité distincte grâce à leur propre langue et coutumes.
Alors que les mouvements anticolonialistes balayaient l’Afrique et l’Asie dans les années 1950 et 1960, les États-Unis ont cherché de nouvelles bases pour maintenir leur influence dans l’océan Indien. Le camp Badaber au Pakistan a finalement fermé ses portes en 1970, lorsque le pays s’est rapproché de la Chine, et la guerre d’indépendance de l’Érythrée menaçait la station Kagnew en Éthiopie. La perte de ces deux bases aurait porté un coup dur aux activités du renseignement américain sur les activités soviétiques.
Diego Garcia avait le potentiel de combler ce vide, mais deux problèmes se posaient : les îles dépendaient de Maurice, et étaient habitées.
En violation des normes juridiques internationales, la Grande-Bretagne a fait pression sur Maurice pour qu’elle renonce à l’archipel des Chagos.
Puis vint le nettoyage ethnique. Pour intimider les insulaires, leurs chiens, animaux de compagnie bien-aimés, ont été tués en masse par balle ou gazés. La plus grande plantation a été fermée, privant ainsi la population de son gagne-pain.
Les vivres et les médicaments ont été restreints afin de décimer la population ou de la forcer à partir. En 1971, ceux qui étaient restés ont été informés devoir obtenir un permis légal, ce que personne n’a obtenu. Sans préavis, beaucoup ont été contraints de quitter leurs foyers. Comme leurs ancêtres transportés dans des bateaux négriers, les Chagossiens ont été entassés à fond de cale pour fuir les îles.
Une tête de pont pour une guerre sans fin
Avec l’île vide et sa piste d’atterrissage prolongée, Diego Garcia est rapidement devenue un élément central de la stratégie militaire américaine. Elle a joué un rôle clé dans la mission ratée de sauvetage d’otages en Iran en 1980, l’«Operation Eagle Claw», puis contre l’Iran durant la guerre Iran-Irak.
En 1987, la piste a été améliorée pour permettre le stationnement de bombardiers américains B-52, capables de transporter d’importantes cargaisons et des munitions à guidage de précision. Ces bombardiers ont joué un rôle crucial durant la guerre du Golfe pour attaquer les centres de commandement et de contrôle irakiens, puis à nouveau au début des invasions et occupations de l’Afghanistan et de l’Irak.
À mesure que les États-Unis étendaient leur présence dans le golfe Persique, les bases du Qatar et de Bahreïn ont pris une importance croissante, accueillant des bombardiers longue portée, le quartier général du Commandement central américain (CENTCOM) et la cinquième flotte de la marine américaine. Ces deux bases ont joué un rôle crucial : les bombardiers du Qatar et les navires de Bahreïn ont contribué à frapper les bastions des talibans lors de l’invasion de l’Afghanistan, puisont frappé Bagdad lors de la campagne «Shock and Awe» [Choc et stupeur].
Mais la proximité du champ de bataille est devenue une arme à double tranchant. L’important arsenal de missiles de l’Iran, y compris des missiles hypersoniques, dont il a fait la démonstration lors de ses représailles contre Israël en octobre 2024, rend ces bases du golfe Persique particulièrement vulnérables.
Cette proximité est également un défi pour les bombardiers furtifs B-2, qui peuvent être détectés au niveau du sol et pendant le décollage. Avec seulement 20 B-2, coûtant 2 milliards de dollars chacun, c’est un luxe que les États-Unis ne peuvent pas se permettre. Si la guerre éclate, Téhéran ne devrait pas épargner les infrastructures économiques de ses voisins.
Il est peu probable que le Bahreïn ou le Qatar soient prêts à supporter le coût d’une attaque iranienne. L’Iran pourrait non seulement attaquer les bases militaires américaines, mais aussi les infrastructures pétrolières et gazières, qui anéantiraient leurs équilibres économiques. Les deux pays se sont également rapprochés de l’Iran : Téhéran a été l’une des rares capitales à soutenir le Qatar durant sa crise diplomatique avec l’Arabie saoudite et d’autres émirats du golfe Persique. Au cours de l’année écoulée, le Bahreïn et l’Iran ont également œuvré au rétablissement de leurs relations.
Diego Garcia, en revanche, se trouve bien au-delà de la portée de la plupart des missiles iraniens – du moins selon les estimations actuelles. Elle permet à des bombardiers furtifs de décoller sans être détectés, et la capacité limitée de l’Iran à punir les suzerains britanniques de l’île en fait un terrain d’entraînement idéal pour les desseins guerriers de Washington.
Selon les données disponibles, le missile iranien à la plus longue portée est le Khorramshahr-4, avec un champ d’action d’environ 2000 kilomètres. Or, la base militaire américaine de Diego Garcia, située au cœur de l’océan Indien, se trouve à près de 4000 kilomètres de la côte sud de l’Iran. Bien qu’on ne dispose d’aucune preuve confirmée que l’Iran dispose actuellement des moyens de frapper une cible aussi éloignée, on ne peut totalement exclure l’existence de capacités – non divulguées par la République islamique – susceptibles d’atteindre la base américaine.
De plus, la capacité avérée du missile Khorramshahr-4 à échapper aux défenses aériennes israéliennes soulève des inquiétudes quant à la capacité des États-Unis à défendre Diego Garcia en cas de conflit majeur, en particulier si l’Iran possède des missiles à longue portée capables de frapper cette base isolée.
Toute attaque contre l’Iran risque de déclencher une guerre régionale de plus grande ampleur, avec des répercussions sur les intérêts et les alliés américains dans toute l’Asie occidentale, de Tel-Aviv à Riyad. Tuer quelques dirigeants iraniens pourrait constituer une victoire symbolique, mais la structure de commandement de Téhéran est conçue pour résister. Les risques l’emportent largement sur les gains tactiques.

Une patrie devenue forteresse
Malgré une décision de la Cour internationale de justice (CIJ) de 2019 exigeant que la Grande-Bretagne mette fin «dès que possible» à son administration des îles Chagos, les Chagossiens n’ont toujours pas obtenu justice. Bien que Londres ait accepté en octobre 2024 de lancer le processus de restitution de l’archipel à Maurice, la base américaine est toujours en place. L’île Maurice a proposé un bail de 99 ans, sans garantir le droit au retour des Chagossiens expulsés.
Ce bail pourrait bientôt devenir permanent. Si une guerre éclate, Diego Garcia pourrait à nouveau être agrandie, davantage militarisée et devenir inhabitable. Une forteresse de béton serait alors tout ce qui reste de ce qui fut autrefois une patrie paisible.
Au final, que ce soit en raison d’une frappe militaire ou par inertie impérialiste, les Chagossiens risquent de perdre leurs îles à jamais, non pas aux mains de l’histoire, mais des guerres livrées par les États-Unis.
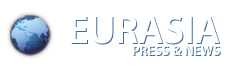 Eurasia Press & News
Eurasia Press & News