Le contrôle colonial sur notre continent, qui a exclu les êtres humains de leurs droits pendant plus de 500 ans, nous laisse avec cette question : les droits de l’homme peuvent-ils être considérés comme universels ?
Mercantilisme colonial et humains sans droits
Dans un article intitulé «L’Histoire comme arme», le célèbre chercheur cubain Manuel Moreno Fraginals affirme que les historiens travaillent avec des documents provenant presque entièrement des classes dirigeantes.
De ce point de vue, une autre hypothèse pourrait émerger. Le savoir juridique émanant de toute puissance coloniale définit une notion d’humanité, exclut de droits les êtres humains qu’elle soumet et considère qu’elle a le pouvoir de les accorder ou de les refuser.
De cette façon, historiquement, le colonialisme – passé et présent dans les Amériques – définit les droits des humains et les humains sans droits, transformant ces derniers en choses dépourvues d’humanité.
La lucidité d’Horacio González nous a laissé une phrase imbattable : «il n’y a pas de pouvoir sans écriture».
Le principe de toute sujétion commence au moment où les règles du jeu émergent, c’est-à-dire comment elles gouverneront, comment elles seront appliquées, qui aura ce pouvoir et sur qui il retombera.
Il s’agit donc de découvrir qui a le pouvoir de concevoir l’architecture juridique, de démêler la portée d’un récit, d’observer comment il est diffusé, d’analyser sa légitimité, de vérifier si il est contestable, de noter si il contient une vérité partielle et d’observer attentivement si ce pouvoir est tel qu’il empêche de proposer une autre version.
La domination sur quelque chose ou sur quelqu’un peut s’exercer avec des faits, rien de plus. Or, celui qui utilise la force pour vaincre un autre humain, usurper son territoire et le soumettre à volonté, s’avère le vainqueur, mais cet événement ne suffit pas à reconnaître son pouvoir. Si d’autres prétendaient la même chose, des conflits permanents surgiraient.
Une extériorisation qui en rend compte n’est suffisante que s’il s’agit d’un document légitime : les normes juridiques – afin d’éviter l’imposition de la loi du plus fort – sont celles qui déterminent qui a ce pouvoir.
La plume, perfectionnée à l’époque de la colonisation américaine, provient d’éminents jurisconsultes. Ils avaient réussi à fusionner un modèle entre le Droit Romain et le Droit Canonique, ce qui a donné naissance à un ensemble de réglementations dites romano-canoniques, qui couvraient toutes les disciplines juridiques.
Parmi eux, se distingue Jean Bodin, juriste français, au cœur du conflit entre catholiques et protestants. Aussi parce que ses textes étaient une référence et se sont répandus dans toute l’Europe.
Le vieux continent est entré en contact avec d’autres populations en raison de ses rivalités au cours des siècles. Un fait particulier fut que le Portugal a commencé à faire le trafic d’Africains noirs comme marchandise, de sorte que ces êtres humains furent également connus en France. Bodin respirait le mépris. À leur sujet, il soutenait que les relations sexuelles entre ces hommes et des bêtes étaient à l’origine de la naissance de monstres sur ce continent. En ce qui concerne les femmes, Bodin n’était pas moins brutal. Pour cet auteur, il s’agissait d’êtres inférieurs, mais il s’est arrêté, en particulier, pour formuler une théorie juridique qui pourrait éliminer ceux considérés comme des alliés de Satan : «les sorcières».
Pour justifier l’extermination massive des sorcières ou de celles soupçonnées l’être, le démonologue probablement le plus important a utilisé un argument singulier : le danger dans lequel tomberait la République si ce mal n’était pas éradiqué.
Le juriste et avocat français Jean Bodin, qui est considéré dans la théorie politique comme l’un des premiers auteurs du XVIe siècle à définir le concept de souveraineté, est également celui qui a travaillé à en définir la portée.
La souveraineté politique, selon Bodin, ne pouvait pas être comprise si elle n’englobait, en même temps, quelque chose d’inhérent à l’exercice du pouvoir absolu : «les corps».
Le roi a défini, à travers la souveraineté politique qu’il détenait, le concept d’humanité ; Cette définition lui appartenait exclusivement : «tout être humain acquérait des droits par la grâce du plus haut représentant du pouvoir terrestre».
L’Humanité fut ainsi désintégrée ; Cette belle expression était légalement documentée : «il n’y avait pas de pouvoir sans écriture».
La découverte de territoires abritant des populations inconnues a permis aux occupants d’utiliser cette définition de l’Humanité désintégrée comme un outil juridique, progressivement affiné, pour exercer le droit de domination sur ces êtres humains.
Lors de la conquête de l’Amérique, ce récit n’était pas nouveau ; les lois ou dispositions légales précédentes étaient similaires à celles d’autres populations découvertes sur le continent africain.
Les monarques catholiques, qui montèrent sur le trône en 1494, furent les architectes d’un puissant empire espagnol. À cette fin, depuis la Castille, ils ont mené une guerre dont l’objectif était de récupérer les territoires conquis par les Maures. En 1491, la victoire de Grenade fut d’une grande importance car, d’une part, elle consolida le pouvoir politique de la monarchie et, d’autre part, son pouvoir religieux. Après cette reconquête, ils établirent des règles sur la propriété des esclaves, c’est-à-dire de ceux qui avaient été vaincus, qui devinrent automatiquement des objets : «les Maures».
Dans ce contexte, la couronne espagnole, qui entamait une réunification territoriale, avait accordé à Christophe Colomb l’opportunité d’explorer de nouvelles terres. Après la découverte de l’Amérique, il lui accorda les titres de vice-roi et de gouverneur général des Indes pour lui-même et ses descendants.
L’objectif initial de Colomb, comme celui d’autres navigateurs et corsaires, était de trouver de nouvelles marchandises, l’or étant sa priorité, au-delà des lettres qu’il envoyait aux Rois Catholiques. L’utilité des richesses trouvées – disait-il dans les lettres – lui permettrait de mener une croisade religieuse pour récupérer la Cité de Dieu. Son expérience de gouvernement à Hispaniola [Haïti – Saint-Domingue] s’est terminée par un procès pénal et il fut démis.
Cependant, il avait trouvé une plante prometteuse sur le nouveau continent pour l’exportation et la commercialisation : «la canne à sucre».
L’écrivain brésilien Gilberto Freyre s’est attaché à distinguer les conquêtes des empires coloniaux qui se disputaient l’Amérique. L’auteur de «Casa-Grande e Senzala» soutient que les Espagnols ont accéléré la dissolution dans les territoires colonisés, tout comme l’ont fait les Anglais. Ces empires imposaient la rigueur aux êtres humains dont la pigmentation de la peau était foncée et prenaient soin d’imposer la morale chrétienne. Contrairement à eux, dit Freyre, les Portugais du Brésil étaient moins ardents, ce qui a permis la formation d’une société brésilienne hybride, entre les peuples autochtones et les Portugais. La population Mamelouke, c’est-à-dire métisse, a réussi à mieux s’intégrer socialement. Néanmoins Freyre a également souligné une situation différente concernant l’esclave africain.
La colonisation française en Amérique est arrivée plus tard, les territoires étant d’abord occupés par des corsaires et des aventuriers. La monarchie s’intéressera plus tard aux territoires d’Amérique du Nord, d’abord au Canada puis à la Louisiane, jusqu’à ce qu’elle prenne le contrôle des Antilles, non protégées par la couronne espagnole.
Au-delà de toutes ces considérations, la réalité montre que le mercantilisme a eu des conséquences sur la vie et le corps des indigènes et des esclaves.
Les exécutions, précédées de torture, de travail forcé et d’enlèvement de femmes et d’enfants furent parmi les actes les plus brutaux qui inaugurèrent la soumission des vaincus. De plus, le viol des femmes a conduit à la naissance d’enfants métis et à la ségrégation raciale qui a suivi.
Tous les pays européens impliqués dans la traite des esclaves dans le Nouveau Monde avaient leurs propres navigateurs, corsaires ou compagnies maritimes. Les ports espagnols, portugais, anglais, français et néerlandais ont été ceux qui ont stimulé le développement de leurs économies grâce au commerce de biens et de personnes.
Grâce aux compagnies maritimes créées pour la traite négrière, cette dernière devint l’activité la plus lucrative de l’époque ; bien que son plus grand essor ait été atteint au XVIIIe siècle. La commercialisation des matières premières américaines était une nouvelle source de revenus économiques.
Au XVIIe siècle, la Compilation des lois des Indes, commandée par la couronne espagnole, tout comme le Code noir français, étaient les normes juridiques qui résumaient la pratique de ces activités coloniales à cette époque.
Ces textes entérinent une fois de plus des humains sans droits, comme des choses mobilières ou des objets dépourvus d’humanité.
Le texte transformé a été copié dans le presse-papier : il ne vous reste plus qu’à le coller (Ctrl-V) dans SPIP. Bonne chance !
L’économie invisible et l’être humain au-delà de la terre
Si l’on prend une histoire conventionnelle de la conquête et de la reconnaissance des droits de l’homme, deux moments d’apogée pourraient être mis en évidence : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui doit son empreinte à la Révolution française de 1789, et la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
Tous deux méritent cependant quelques éclaircissements et réserves. Ces textes doivent être liés à un commerce international en expansion, qui a généré des richesses dans des nations dont les colonies, conquises des siècles plus tôt, ont continué à produire des matières premières de grande valeur. Les droits de l’homme proclamés n’étaient pas sans ambiguïté, car cette économie coloniale n’était même pas mentionnée et laissait certains humains en dehors de l’univers du droit.
La révolution française des droits de l’homme trouve ses origines dans l’impulsion des Lumières. Les œuvres de Montesquieu, Rousseau, Voltaire et Diderot, et en droit pénal, de Alessandro Verri et Cesare Beccaria, ont eu un impact profond et irréversible. Ces auteurs, comme d’autres, représentaient un mouvement qui s’appelait les Lumières, dont la pensée proposait des réformes novatrices en réponse à la fin décadente d’un régime despotique et inhumain.
Avec la prise de la Bastille, symbole d’oppression, la Révolution française de 1789 a amorcé ces transformations et les a inscrites dans un texte juridique de grande importance qui allait définir les droits de l’homme ou ses droits humains inaliénables.
La publication du Code noir de 1685 dans les années 1980 a jeté un sérieux doute sur la portée universelle de ces droits. La critique vigoureuse de Louis Sala Moulins sur le silence ou les idées pro-esclavagistes des représentants de la pensée des Lumières, qui étaient conscients de son existence, est extrêmement intéressante pour comprendre la continuation de l’esclavage en France jusqu’en 1848, de même qu’un racisme historique durable.
Sala Moulins détaille que : Voltaire disait que chez les Africains l’intervalle qui sépare un singe d’un Noir était difficile à comprendre. Montesquieu, dans «De l’esprit des lois», défend le droit de propriété sur les esclaves noirs. En ce qui concerne la traite des esclaves, il a soutenu le travail dans les colonies américaines qui était bénéfique. Rousseau est resté silencieux sur l’esclavage dans toutes ses œuvres.
Ces mêmes êtres humains, privés d’humanité depuis le XVIe siècle, avec la conquête de l’Amérique, ont été ignorés dans les débats qui ont précédé le texte sur les droits de l’homme considéré comme l’un des plus pertinents.
Depuis cette «Déclaration de l’Homme et du Citoyen», les principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui semblaient universels, n’ont pas atteint tous les êtres humains. Après cela, il y eut une abolition de l’esclavage symbolique.
Il n’a fallu que quelques années à Napoléon Bonaparte pour profiter de la traite négrière en Amérique et financer l’expansion territoriale d’un Empire, comme l’avait fait Louis XIV, le Roi Soleil, un siècle et demi plus tôt.
Peut-être devrions-nous analyser en termes économiques l’échec annoncé de l’abolition de l’esclavage et pourquoi les colonies américaines n’ont pas pu obtenir leur indépendance.
Les discussions dans les débats depuis 1789 ont pris en compte ce qui suit : sur les 350 millions de livres que la France a exportées pendant la Révolution, plus de 160 millions étaient des produits coloniaux, c’est-à-dire que sans ces marchandises la balance commerciale aurait été déficitaire pour la nouvelle bourgeoisie. C’est pourquoi l’argument économique était toujours présent lorsque l’on débattait des droits humains universels.
Des années plus tard, le Code civil et Code pénal de Napoléon furent en vigueur et considérés comme des chefs-d’œuvre du droit. Ces textes juridiques ont servi de modèle universel, de sorte qu’au XIXe siècle, la codification a consolidé le droit positif et conçu les relations entre les individus et entre eux et l’État.
Une fois de plus, les normes juridiques régissaient le droit de propriété, de possession, de vente et d’achat de biens meubles sans humanité : «les esclaves».
Cependant, les règlements punitifs dans les colonies les plaçaient dans une situation plus défavorable que les animaux : si les bêtes n’étaient jamais passibles de châtiment en droit pénal, les esclaves étaient punis pour simple désobéissance, pour avoir tenté de s’émanciper, punitions publiques ou privées.
À titre d’exemple : si un esclave devait être puni, il fallait considérer, tout d’abord, que les biens du propriétaire ne soient pas affectés, dans le cas de la peine de mort.
Au XIXe siècle, l’indépendance des pays de notre continent s’est produite grâce à des révolutions populaires liées à des événements politiques survenus en Europe : l’arrestation du roi d’Espagne par Napoléon allait déclencher un nouveau scénario dans les colonies espagnoles.
La conquête des droits, pour ces peuples jusque-là dépendants, était d’abord et avant tout la souveraineté. Cette indépendance a été obtenue par certains pays, mais elle n’a pas atteint d’autres, qui ont continué à être colonisés avec une main de fer ou avec des variantes de la forme d’esclavage.
Les colonies espagnoles ont empêché, par tous les moyens, que les informations sur la Révolution française parviennent, par exemple, à Cuba. Les soulèvements au Venezuela furent sévèrement réprimés et considérés comme des vices que les esclaves imitaient dans d’autres colonies. En Guadeloupe, sous la domination française, l’esclavage fut aboli, mais les anciens esclaves furent contraints de travailler pour leurs anciens maîtres. Des sanctions étaient prévues pour ceux qui refusaient : châtiments corporels et peine de mort. La libre circulation des Noirs était interdite et ils devaient rester là où ils étaient hébergés. Ils ne sortiraient que pour travailler, on leur donnerait de la nourriture et des vêtements.
Le XXe siècle suit la même ligne que les précédents : colonialisme, marchés générateurs de richesse et définitions des droits de l’homme qui ne s’étendent pas à tous.
La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 était en grande partie similaire à celle de 1789.
Les droits de l’homme ne sont pas pour tout le monde. L’égalité, la liberté ou l’universalité proclamées excluaient les êtres humains colonisés. À cette occasion, la communauté internationale a évité d’évoquer la décolonisation des pays africains. La dépendance de ces peuples n’a pas suffi pour créer une dans cette universalité sans provoquer de souffrance. Alors que ce texte juridique, considéré comme hautement significatif dans l’histoire des droits de l’homme, continuait de régir des règles de soumission inhumaines dans les colonies.
En Afrique, les restrictions imposées aux déplacements des peuples autochtones dans les régions où résidaient les Européens, l’interdiction d’assister à des spectacles publics, d’acheter ou de vendre des boissons alcoolisées, de posséder des biens immobiliers ou le fait d’être soumis à la flagellation étaient quelques-unes des règles qui n’avaient que peu à voir avec les droits humains universels consacrés.
L’indépendance de ces pays africains dépendants ne sera obtenue, dans certains cas, que vers les années 1960 et, dans d’autres, presque à la fin du XXe siècle.
Ces êtres humains sans droits pourraient faire partie de l’histoire oubliée des droits de l’homme. Une autre désintégration du concept d’humanité, fondé sur les revenus économiques générés par le commerce de biens provenant de pays dépendants grâce au travail forcé de biens meubles. Selon la théorie, certains êtres pourraient devenir proches des humains, d’autres ne le seraient jamais. La théorie de l’assimilation ou la psychologie de la dépendance étaient les idées invoquées.
Dans le même temps, un autre colonialisme régional est né sous l’impulsion des États-Unis : la dite Doctrine de Sécurité nationale a été exportée dans tous les pays des Amériques. Les modèles politiques furent également réutilisés, mais ils se distinguaient par leur économie : «capitalisme contre communisme».
Cette politique colonialiste a donné lieu à des coups d’État, à des génocides, à des crimes contre l’Humanité et à d’autres violations des Droits de l’Homme. Pendant des décennies, elle a causé des centaines de milliers de morts, des détenus disparus, des prisonniers politiques, des tortures, des tourments, des exterminations de populations indigènes ou noires, etc.
Certains pays ont été envahis par des armées étrangères ; D’autres, ce furent leurs propres dirigeants qui ont cédé leur souveraineté.
Dans les années 1970, on parlait d’une croisade morale imitant l’évangélisation pour promouvoir une politique punitive en matière de drogue. Le président américain Richard Nixon prônait une autre guerre parallèle, avec des conséquences différentes. Le colonialisme s’intéressait désormais à un commerce lucratif de marchandises interdites.
Une comparaison a été utilisée : le terrorisme subversif et les drogues interdites représentaient la même nocivité.
Cela a servi de prétexte à leur ingérence extérieure, par le biais d’organisations telles que la CIA, la DEA et les ambassades des États-Unis d’Amérique, en promouvant la signature de traités d’extradition et en utilisant des bases militaires sur tout notre continent.
Naturellement, les dictatures latino-américaines qui adhéraient à la Doctrine de Sécurité nationale étaient celles qui combattaient une subversion qui violait les valeurs occidentales et, à la lettre, mettaient en œuvre une politique criminelle sur les drogues illégales, comme si les deux combats étaient synonymes.
La politique prohibitionniste contre les drogues, en particulier la cocaïne, a démontré l’intérêt international pour les profits extraordinaires générés par cette économie parallèle.
Dans les années 1990, alors qu’étaient connues les graves violations des droits de l’homme commises par les dictatures militaires du Cône Sud, une puissante politique répressive contre les drogues illégales a été renouvelée, accompagnée, cette fois, d’un modèle économique de contrôle colonial dans les pays d’Amérique latine : le «Consensus de Washington».
Alberto Fujimori, président du Pérou entre 1990 et 2000, sous prétexte de lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue, fut un exemple de cette politique répressive. L’intervention des forces de sécurité à Barrios Altos et à La Cantuta a conduit à des meurtres de masse et à d’autres violations des droits de l’homme. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a condamné l’État péruvien pour ces crimes, et les responsables de ces crimes ont ensuite été punis dans leur propre pays.
Le pouvoir de l’argent et l’effondrement humanitaire
La conquête coloniale de notre continent, qui se poursuit sous diverses formes, ravive le mercantilisme européen des siècles précédents et produit les mêmes conséquences : d’autres victimes du colonialisme ont des caractéristiques humaines mais pas de droits ou seulement quelques-uns, dans une économie mondialisée.
Le monde d’aujourd’hui a parfois besoin d’une économie parallèle différente, capable d’échapper aux réglementations et de servir des objectifs différents.
Certains traités ou conventions internationaux, dont la légitimité et le consensus sont indiscutables, ont ouvert des possibilités d’émergence de marchés illicites.
L’efficacité invoquée sur les normes pénales dans tous les pays interdisant la fabrication, la distribution et le commerce de certains stupéfiants, n’a pas pu être prouvée dans les faits ; L’interdiction de certaines drogues a rendu la demande si importante qu’elle a ouvert la voie à des activités illégales, dont les profits ont dépassé toutes les attentes, même comparés à d’autres produits de base mondiaux.
La cocaïne, produite dans seulement trois pays de notre continent, a permis une économie souterraine mondiale qui se développe d’année en année, se positionnant comme l’une des plus importantes.
Dans les colonies américaines, ce sont les matières premières telles que le sucre, le café, le tabac et les métaux qui ont permis d’augmenter la demande internationale. De cette façon, le commerce international a renforcé les caisses et la puissance militaire des monarchies européennes. Ce modèle nécessitait du travail humain pour garantir que les marchandises atteignent leur destination.
Aux États-Unis d’Amérique, la cocaïne, un alcaloïde interdit, devient une source de revenus pour le commerce international. La lutte pour le contrôle du commerce mondial de la cocaïne est comparable à ce qui s’est passé avec d’autres produits de base à l’époque coloniale.
La colonisation autochtone a exterminé les communautés du nouveau continent afin que les matières premières puissent être échangées. L’exploitation humaine par le confinement dans des plantations, les «Encomiendas» ou les «Mitas» étaient des camps de concentration dont les territoires couvraient tout le continent. Ils ont privé des millions de personnes de leur liberté.
Dans le commerce illégal de cocaïne, les chiffres ne mentent pas sur le nombre alarmant de morts violentes et de disparitions forcées de personnes qui se trouvent entre la production et la commercialisation. Les prisons des Amériques sont surpeuplées de détenus dont les activités sont liées à ce commerce illicite.
Les humains sans droits étaient définis à l’époque coloniale comme des biens meubles, de sorte que quelqu’un puisse exercer le droit de propriété sur eux. Concernant les milliers d’êtres humains fongibles ou jetables qui constituent les maillons de ce trafic illégal de cocaïne, en tant qu’objets, toute définition en ce sens entrerait en conflit avec les droits universels, même si la réalité indique que ces droits semblent être des fictions.
Les nègre marrons d’autrefois pouvait difficilement rester libres ; tenter d’échapper au travail forcé était synonyme de la fin de l’existence.
Les esclaves modernes n’essaient même pas. Piégés dans un engrenage parfait, il semble que leur espoir soit de survivre afin de retarder un rituel ou un sacrifice : «la prison ou la mort».
La dépendance économique des personnes vulnérables à ce commerce illégal de cocaïne, qui se traduit dans de nombreux pays par la notion de subsistance, ne leur garantit pas le libre choix, car il n’y a jamais de pénurie d’emplois dans cette économie souterraine. De nombreuses personnes peuvent recevoir des redevances plus ou moins substantielles, d’autres seulement une fraction, et ceux qui sont au plus bas consomment souvent cette substance frelatée pour réduire les coûts, ce qui nuira irréversiblement à leur santé.
Or, le nombre de tonnes de cocaïne produites, distribuées et consommées chaque année dans le monde devrait démontrer les effets nocifs de la cocaïne sur l’ensemble de la population, soit des millions de personnes en risque dans le monde en situation alarmantes par les effets des doses ou des surdoses. Cela entraînerait des décès en masse et des hôpitaux débordés. C’est ce qui s’est passé avec l’opium et l’héroïne. Cela a conduit les États européens à intervenir pour garantir le droit à la santé, ainsi que des réglementations strictes pour garantir que l’opium ne soit pas disponible sur le marché.
Avec la cocaïne, ce n,’est pas le cas. Au contraire, la demande internationale bat des records chaque année, c’est pourquoi la production augmente rapidement pour garantir aux consommateurs d’y avoir accès.
L’usage problématique de la base de cocaïne cause des dommages inimaginables dans les secteurs vulnérables. Il existe des villes connues sous le nom de «Cracolândia», qui rassemblent des milliers de jeunes des quartiers populaires des Amériques, avec la détérioration physique et mentale qui en résulte.
Tous ces humains ne sont rien d’autre que les petits coûts ou les petites pertes prévisibles d’une entreprise mondiale monumentale dont la prospérité est imparable.
Systèmes pénaux et humanité fragmentée
Si la vie était une chute horizontale, comme l’a poétiquement compris Jean Cocteau, dans les Amériques, de nombreuses âmes s’écraseraient soudainement au sol. Le voyage vers la fin de l’existence semble destiné uniquement aux visages centenaires.
Dans cette région, surmonter les vicissitudes d’une structure économique dépendante et du racisme a toujours été un exploit.
Le drame de l’Homo homini lupus est continental a encore des survivants, ils restent en vie, mais ils échappent au pouvoir punitif, ce qui n’est pas facile avec certaines caractéristiques, que l’on appelle stéréotypes.
La vulnérabilité de centaines de milliers d’êtres humains, qui n’ont pas choisi leur lieu de naissance, les confronte à un destin tragique, qui n’est pas fortuit, mais sélectif : «la prison».
Même si cela peut paraître étrange, la punition privée est souvent ignorée. Comme elle ne fait pas partie du système pénal officiel de l’État, son existence est minimisée.
Les États ne sont donc pas les seuls à détenir le monopole de la violence. Un autre système pénal est plus important, il affecte des vies et des libertés ; Dans le trafic international de cocaïne, il semble que le système de justice pénale privée soit la règle.
La cocaïne mérite un traitement différencié car elle est abondante en tant que marchandise interdite et son usage est courant, à tel point qu’elle peut être comparée à certaines substances autorisées comme médicaments et produites par des laboratoires pour être vendues en pharmacie. Contrairement aux brevets détenus par les laboratoires qui fabriquent des drogues légales, lorsqu’il s’agit de cocaïne, ceux qui récoltent les plus gros profits sont ceux qui la commercialisent en gonflant son prix. Ces personnes sont rarement connues car aucun système de justice pénale ne peut les atteindre.
Cependant, la punition publique est extrêmement sélective en ce qui concerne le comportement criminel puni. Les prisons sont surpeuplées à cause du trafic de drogue, qui est fonctionnel à l’économie illégale florissante parce qu’il est connu pour son efficacité avec des quantités minimales, mais suscite également des soupçons selon lesquels il apaise la conscience sociale. On dit que c’est un fléau, mais il touche tous les secteurs de la population.
La punition privée, qui applique la peine de mort pour régler des comptes dans des conflits de production, de distribution et de commercialisation, est si numériquement significative qu’elle dépasse de loin la punition publique, même si elle reste enfermée dans une omission théorique.
La coexistence de sanctions publiques et privées n’est pas nouvelle : il s’agit de structures punitives historiques bien ancrées qui n’ont pas disparu.
Un premier avertissement dans toute pensée critique, si l’on devait trouver une alternative à cette tragédie en Amérique, consisterait à réfléchir sur une autre colonisation qui se manifeste dans différents domaines de la connaissance : «la pédagogie».
Peut-être que la manière dont nous démantelons une économie souterraine mondiale, dont les conséquences produisent de graves violations des droits de l’homme, nous encouragera à nous méfier de concepts, de modèles ou d’idéologies étrangers à notre histoire continentale. Notre région est la plus violente du monde. Le trafic illégal de cocaïne est la principale cause de morts violentes.
Dans ce sens, il semble inapproprié de débattre de la question de savoir si les politiques des gouvernements dits de gauche, de droite, libéraux, nationalistes ou fascistes des États régionaux sont cruciales pour faire face à ce marché illégal, puisque chacun d’entre eux, avec des degrés d’importance variables, recourrait au punitivisme comme solution.
Les images de corps démembrés, pendus, incinérés et disparus, le rassemblement de groupes sociaux peuplant les prisons et la création de la plus grande prison d’Amérique Latine sont effrayantes. Cette déshumanisation représente le coût d’une économie prospère.
Peut-être devrions-nous faire appel à celui qui a élevé la voix au XVIe siècle pour défendre les droits de l’homme : Fray Bartolomé de las Casas.
Le mérite colossal de Las Casas fut d’avoir été le premier à affirmer que la notion d’humanité était indivisible. Cette réflexion indiquait qu’aucun homme ne pouvait se voir refuser des droits, que la domination avait des limites, qu’il n’existait aucune puissance terrestre pour les nier. Bartolomé de Las Casas a clairement indiqué que les Droits de l’homme étaient inhérents à la condition humaine, immuables, non transférables et inaliénables.
L’ecclésiastique de las Casas, surnommé l’Homme de tous les siècles, a également défini pour la première fois les droits humains universels : les peuples indigènes, les colons et les esclaves africains jouissaient de la même conception de l’Humanité, simplement parce qu’il n’y en avait pas d’autre.
Ses idées ont limité la conception de la souveraineté politique de Jean Bodin. Une interprétation extensive de ce que soutenait de Las Casas suffit à conclure que même la souveraineté ou le pouvoir absolu d’une monarchie qui colonisait des êtres inconnus ne pouvait pas définir l’humanité. Chaque personne porte avec elle les droits de l’homme.
La réalité latinoaméricaine [des Amériques et d’ailleurs] actuelle exigerait la lucidité et la dénonciation qu’avait le Père dominicain, pour des actes atroces contre des vies humaines.
Le silence médiatique, l’absence de politiques publiques alternatives de la part des différentes nations de la région, le manque de propositions des organisations internationales et les alliances de pays continentaux sans cet agenda indiquent un manque d’engagement ferme pour prévenir cette grave violation des droits de l’homme en Amérique Latine [et d’ailleurs]. Ce désintérêt témoigne d’une inaction face à l’horreur, ou peut-être ne réalisons-nous pas que cette interdiction est opportune, malgré ce qui se passe. Cette dernière hypothèse engendre un pessimisme sans espoir.
De notre côté, nous ne pouvons que proposer des questions qui nous désorientent, qui nous inquiètent, qui sèment encore plus de doutes en nous :
a) Si toute colonisation définit une notion d’humanité désintégrée, l’histoire des Droits de l’homme comporte-t-elle deux versions ? Le savoir juridique décolonisé est-il un savoir qui reconnaît les droits humains universels ?
b) La doctrine juridique de notre continent peut-elle passer sous silence le fait que les Déclarations historiques, pertinentes pour la reconnaissance des droits de l’homme, contiennent à leur tour une universalité fictive ? La critique de ce récit suffira-t-elle à distinguer la Déclaration interaméricaine des droits de l’homme de ces précédents ?
c) Une théorie juridique critique suffira-t-elle à concrétiser dans la vie réelle la notion d’humanité indivisible, afin de reconnaître les droits humains inhérents à chaque personne ? Sera-t-elle capable de le faire face à une économie souterraine qui s’appuie sur des lois prohibitives et qui utilise les êtres humains comme des objets jetables ?
d) Les incendies intentionnels en Amazonie, dont les dommages environnementaux sont irréparables, ainsi que les trafics agrochimiques dénoncés, ne créent-ils pas des voies terrestres de distribution de cocaïne vers le Brésil, principal exportateur vers l’Europe et deuxième consommateur mondial de cocaïne, après les États-Unis ?
e) Le concept de narco-État peut-il être étendu aux narco-médias, aux narco-entreprises nationales ou internationales ?
f) Dans la violence extrême qui règne à travers l’Amérique, le colonialisme intéressé par ce commerce lucratif sera-t-il celui d’un seul pays ou y aura-t-il d’autres pays, également colonialistes, qui agissent stratégiquement différemment dans la région, mais se disputent la cocaïne entre eux, comme cela se produit, par exemple, avec le pétrole, le lithium, le gaz ou l’énergie nucléaire ?
g) La liquidité monétaire que génère la commercialisation sera-t-elle si importante qu’elle confirmera la thèse selon laquelle cette économie parallèle est globalement nécessaire pour faire face au système financier spéculatif ?
Peut-être que certaines réponses nous permettront au moins de discuter de la crise à laquelle est confrontée la protection effective des droits humains de centaines de milliers de personnes, pour lesquelles ces droits ne sont pas garantis.
Pendant ce temps, les âmes en souffrance, les biens meubles vivants, les objets jetables, les vulnérables qui meurent par centaines de milliers, ou les détenus qui surpeuplent les prisons, attendent qu’on leur rappelle que leurs droits leur appartiennent en tant que personnes.
La pensée de Fray Bartolomé de Las Casas les console : ils ont des droits, car l’Humanité est unique et indivisible.
Mais cette fois, au-delà de son courage, sa voix semble insuffisante.
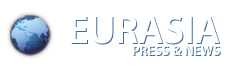 Eurasia Press & News
Eurasia Press & News




